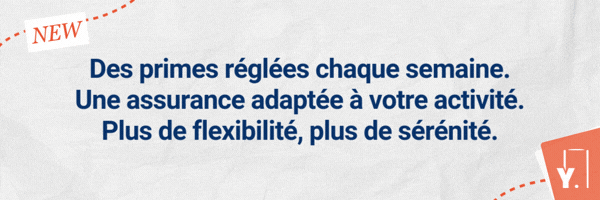Bon c'est entendu, ce pauvre coco a certainement plus un problème d'ordre psychiatrique qu'autre chose:
-Hec avec autant de fautes pour une malheureuse phrase, son correcteur d'orthographe ne parvient même pas à le suivre...
-Il avance dans un 1er temps que de toute façon ses chauffeurs auront leur équivalence après 12 bulletins de salaire (même faux!);s'apercevant ensuite de l'absurdité de son discours(bah oui ses chauffeurs aussitôt la carte acquise se barreront!) il se ravise et explique benoitement qu'il arrêtera de toute façon son activité dans un an.
Au fait, cette maladie a un nom. On l'utilise couramment pour vanner un pote ou un pauvre type, mais chez lui,hélas, c'est pathologique.
Dans les grandes lignes:
Une vie de mythomane n’a rien de facile. Pour rester dans son monde fantasmatique, qui la protège de la dureté du réel, Coco doit en permanence briser les liens noués à la faveur de son errance mentale et géographique : partir, toujours partir. En effet, le pire, pour un mythomane, est d’être placé face à son mensonge et de perdre ainsi sa raison d’être. C’est pourquoi, lorsqu’il est découvert, le mythomane embraye immédiatement sur une nouvelle affabulation.
Si le mythomane ne supporte pas la réalité telle qu’elle est, c’est d’abord qu’il ne se supporte pas lui-même tel qu’il est.
A l’inverse de ce que prétendait le grand psychiatre Ernest Dupré, la mythomanie n’est pas innée. C’est vers 3, 4 ans que les enfants commencent à s’essayer au mensonge : ils maîtrisent alors suffisamment bien le langage et ont désormais compris que les adultes ne savent pas tout ; on peut donc tenter de les tromper. Pour éviter une punition, obtenir une chose refusée…
C’est ainsi que naît le mensonge, celui, banal, dont nous ferons tous plus ou moins usage durant notre vie. Mais le mythomane, lui, par une sorte de décision de l’inconscient et pour éviter les frustrations, s’enfermera dans un univers factice. En fait, pour lui, le réel et la fiction sont équivalents. Le psychiatre Michel Neyraut compare d’ailleurs son existence à une partie de poker, dans laquelle le mythomane ne connaîtrait même pas son jeu. Il abat ses cartes, ses affabulations, « et si personne ne s’est récrié, c’est peut-être que cette carte était la bonne. Au fond, toute carte peut être la bonne ». Il y a une « jouissance » particulière dans la mythomanie : se faire croire à soi-même que tous les désirs sont possibles.
Les mythomanes se recrutent dans tous les milieux. On observe qu’ils ont souvent eu des parents manipulateurs ou, à l’inverse, très crédules. Et qu’ils ont généralement très tôt souffert d’un manque de soutien psychologique – un père ou une mère absent(e), ou trop préoccupé(e) par ses problèmes ou un autre de ses enfants. D’où une précoce et intense solitude intérieure, qui les poursuit et que leur vie imaginaire s’efforce de combler. Mais l’attitude des parents n’est pas seule en cause : bien qu’aimé, le jeune mythomane a été insatisfait de son sort ; il aurait voulu avoir plus d’amour, des parents plus prestigieux.
Les psychothérapies qui viennent à bout des symptômes névrotiques sont rarement aussi efficaces concernant la mythomanie. Pour une bonne raison : si le mythomane est amené à en suivre une, c’est presque toujours à la demande de son entourage, inquiet pour lui, fatigué de ses frasques, de ses errances. Or, pour qu’une thérapie fonctionne, il est nécessaire que la personne qui présente des symptômes soit demandeuse. Lorsqu’il est pris d’angoisse – c’est-à-dire quand sa machine à fabuler se grippe –, le mythomane peut être tenté d’entamer un travail sur lui-même Mais dès que l’angoisse s’apaise, il part. Dans son inconscient, il préfère l’excitante jouissance du mensonge au plaisir tranquille de la réalité ordinaire. De plus, une thérapie est une rencontre avec la vérité, perspective plutôt inintéressante pour un être qui fuit le vrai.
Et pour finir sur les horribles et nombreuses fautes d’orthographe, j'ai sélectionné pour toi et surtout pour les pauvres factures de tes clients (tes comptables doivent être pliés en 2 quand tu leur donnes) celle que tu ne doit absolument plus commettre, au risque de paraitre encore plus idiot que tu ne l'es déjà:
quand tu écris: par moi, je comprends en effet que tu puisses te dire que comme c'est "par" donc par un seul moi c'est forcément au singulier: rajoute un "s" le moi calendaire est invariable, ou alors tu parlais de toi en écrivant "par moi" en parlant de toi et là je ne serais pas plus étonné que cela, étant donné que tu ne parles que de toi et de ta supposée vie imaginaire.
bien à toi...